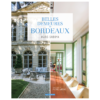Appel à communications : « Le commerce et ses représentations. L‘activité marchande dans les arts et l’architecture aux XVIIe et XVIIIe siècles »
COLLOQUE DU GRHAM ET DU GHAMU
12-13 juin 2025,
Paris, Galerie Colbert, salle Jullian (Université Paris 1/INHA), 2 rue Vivienne, 75002 Paris.
ARGUMENTAIRE
Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, les nombreuses transformations et l’expansion significative des activités du commerce engendrent la diversification des consommations et l’élargissement des aires commerciales. Ces phénomènes témoignent de l’amélioration des conditions de transport, d’une meilleure organisation des réseaux marchands et des ressources du capitalisme. Les images et la littérature autour du monde marchand se diversifient alors et transforment la perception que la société a de cette pratique et de ses acteurs (colporteurs, marchands ambulants, fabricants, grossistes, entrepreneurs, etc.). Si l’idéal du mercator sapiens (Caspar van Baerle, Athenaeum Illustre, 1632) se réalise progressivement et trouve au XVIIIe siècle son point d’aboutissement, l’opposition entre l’otium et le negotium continue à se modifier, la noblesse s’intéressant de plus en plus aux activités lucratives du grand commerce et de l’industrie. Comment les artistes perçoivent-ils ces transformations sociologiques qui propulsent sur le devant de la scène des personnages jusqu’alors souvent ignorés ?
Le développement du commerce sous toutes ses formes appelle également au renouvellement et à la multiplication des types architecturaux existants, ainsi qu’à la mise en place de programmes nouveaux. Du comptoir de la boutique à la place, du marché et du bazar à la foire annuelle, des ports de l’Atlantique et des grandes bourses hollandaises et hanséatiques aux han du monde islamique, les lieux d’échange sont multiples, polymorphes et hybrides. À leur tour, les espaces de commerce spécialisés transforment la ville (grands axes de circulation, zones de stockage, etc.) dont l’accroissement ne saurait plus se contenter des maisons de guilde et des places du marché.
Ancré dans la cité, le système corporatif est ébranlé par la transformation du commerce. Si elles contribuent à défendre et protéger les intérêts de chaque profession depuis le Moyen Âge, les communautés d’arts et métiers sont jugées de plus en plus contraignantes en Europe. Les conflits entre ces différents acteurs et institutions modifient les cadres de l’exercice du commerce dans la ville. Comment la représentation de ces lieux de sociabilité professionnelle traduisent-elle ces évolutions ?
L’essor du capitalisme commercial s’accompagne enfin d’une amélioration des voies de communication : la navigation fluviale bénéficie de l’expansion des canaux et les liaisons routières sont aménagées et pavées en soutenant le développement à la fois du commerce intérieur et extérieur. Fondées au XVIIe siècle, les Compagnies coloniales européennes connaissent au XVIIIe siècle une expansion tous azimuts, le commerce ne se pratiquant plus en droiture mais de manière triangulaire. Comment les artistes traduisent-ils cet attrait pour le commerce international ? Quels sont les projets emblématiques menés par les architectes pour asseoir la réputation des sociétés se préoccupant du commerce transatlantique ?
Le colloque s’organisera autour des trois axes principaux suivants :
- Axe 1 : Stratégies d’investissement du domaine de l’image par les marchandes et les marchands.
- Axe 2 : Modalités de représentation du commerce « en action » et de ses lieux d’exercice.
- Axe 3 : L’activité commerciale comme vecteur de formes, d’idées et d’images à l’échelle européenne et extra-européenne.
Les propositions de communication pourront s’inscrire dans l’un ou plusieurs de ces axes, sans s’y limiter. Étant précisé que le comité de sélection privilégiera des contributions sortant du paradigme du marchand d’art et du marchand mercier.
Le premier axe voudrait questionner les stratégies d’investissement du domaine de l’image par la marchande et le marchand. En plus des images variées de ces acteurs – souvent positives, parfois pittoresques –, cet axe propose d’appréhender les pratiques et les représentations artistiques qu’ils ont mises en œuvre pour élaborer une image d’eux, de leur rôle ou de leur place dans la société. Parmi ces pratiques, on pourra notamment prendre en compte le mécénat, le collectionnisme, la spéculation, ou encore des techniques valorisées socialement, telles que l’apprentissage et la pratique du dessin. Il sera possible d’aborder les différents types de portraits, qu’ils soient individuels ou de groupes. De même, on pourra examiner les formules architecturales codifiées ou pensées pour leur praticité au regard du statut et de l’activité du maître d’ouvrage. Ces diverses pistes d’étude seront également l’occasion de se questionner sur l’existence d’un « goût marchand » caractérisé, qu’il ait été volontairement fixé par les marchands eux-mêmes ou constitué sur la base de critiques venant d’autres classes de la société et diffusé entre autres par la gravure. Il ne s’agira toutefois pas d’essentialiser les bourgeois commerçants mais d’identifier plus finement des représentations communes ou, au contraire, d’en souligner les spécificités.
Le deuxième axe s’attachera à explorer les modalités de représentation du commerce « en action » et de ses lieux d’exercice. Comment les arts visuels et l’architecture ont-ils reflété, accompagné, encadré ou orienté la pratique du commerce ? Les bouleversements économiques des sociétés préindustrielles et l’élargissement du champ du représentable par la modernité artistique ont bousculé l’iconographie des pratiques commerciales. Cet axe entendra favoriser les études formelles et iconographiques sur les commerces peu représentés par les arts ; celles qui interrogent la domination iconographique de certaines scènes marchandes ; et celles qui questionnent le hiatus entre la réalité des pratiques et leur représentation. Aux côtés des recherches sur la boutique, ses décors et l’art de l’« étalagisme », il s’agira également d’ouvrir les perspectives à l’architecture commerciale européenne ou extra-européenne. Comment les architectes conçoivent-ils leurs projets pour ces édifices de commerce ? Le type architectural pourra être compris dans son acception la plus large, en intégrant l’ensemble des bâtiments avec une affectation marchande ainsi que les édifices et les espaces publics liés à la commercialisation des plaisirs et des loisirs.
Ce corpus graphique, pictural, sculptural et architectural devra s’enrichir de l’ensemble des images qui, sans représenter une pratique et un lieu marchands précis, véhiculent un discours mercantile à connotation politique ou religieuse. Quelles représentations et iconographies les artistes privilégient-ils pour évoquer l’idée du commerce dans leurs œuvres ? Mobilisant l’allégorie, la fable, la philosophie ou les livres de parole, ces discours, souvent diffusés par la gravure, s’affichent aussi sur les façades ou s’affirment à travers de grands programmes édilitaires.
Le troisième axe visera à ouvrir le sujet aux diverses facettes de l’activité commerciale comprise, à l’échelle mondiale, comme vecteur de formes, d’images et d’idées, ainsi que de circulation des personnes et des matériaux. En effet, les échanges marchands entre les cités et les nations ont favorisé l’aménagement des voies commerciales (routes, ponts, phares, ports, etc.), la production d’équipements spécifiques (bourses, douanes, etc.) et jusqu’à la fondation de villes nouvelles (comptoirs commerciaux). Il conviendra donc de s’interroger sur les conséquences occasionnées par le développement du commerce intérieur et extérieur sur le territoire, au travers de la production architecturale et visuelle.
COMITE ORGANISATEUR
Élisa Bérard (doctorante, Sorbonne Université), Maxime Bray (doctorant, Sorbonne Université), Justine Cardoletti (doctorante, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Florence Fesneau (docteure, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Barbara Jouves-Hann (docteure, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Maxime-Georges Métraux (expert, Galerie H. Duchemin), Alice Ottazzi (post-doctorante, Kunsthistorisches Institut in Florenz), Maël Tauziède-Espariat (maître de conférences, Université Paris-Nanterre), membres du bureau du Groupe de Recherche en Histoire de l’art moderne (GRHAM).
Clémence Pau (docteure, Sorbonne Université), Jean Potel (doctorant, Sorbonne Université), membres du Conseil d’administration du Groupe Histoire Architecture Mentalités Urbaines (GHAMU).
Échéance
31 mars 2025
Modalités
Les propositions de communication, individuelles ou collaboratives, en français ou en anglais, d’environ 300 mots, pourront prendre la forme de propos généraux ou d’études de cas. Les candidats sont priés de joindre un curriculum vitae.
Envoi des propositions et contacts : asso.grham@gmail.com.
Gerrit Adriaensz Berckheyde, La place du Dam, Amsterdam, 1668, huile sur toile (détail), Anvers, musée des Beaux-Arts d’Anvers.